La sensorialité dans la Ligne du Temps
Rencontres avec Cécile Choimet et Chloé Adrien,, deux thérapeutes, pour découvrir d’autres façons de « lire » la Ligne du Temps, en particulier pour des patients ayant des particularités sensorielles
Interviews réalisées et rédigées par Maryline Puysségur et Pascale Rousvoal -Molin
Article édité dans la newsletter de l’Association LI France
Indépendante des organismes de formation, LI-France est une association de thérapeutes formés à la thérapie LI-ICV.
Cécile est psychologue clinicienne et psychothérapeute intégrative, formée en psycho traumatologie centrée compétences et en LI-ICV. Dans sa pratique clinique, elle a parfois été confrontée à des difficultés, des résultats décevants avec l’approche en LI-ICV – notamment pour l’établissement de la Ligne du Temps ou l’accordage – avec des personnes traumatisées, présentant en plus, un Trouble du Spectre Autistique (TSA), identifié ou non. Au travers des échanges avec l’une de ses collègues, Chloé, psychologue spécialisée dans le handicap, qui accompagne notamment des adultes présentant un TSA, la prise en compte des particularités sensorielles de ces patients est apparue comme une clef de lecture intéressante.
La Ligne du temps, utilisée dans tous les protocoles LI-ICV, amène le thérapeute à lire à haute voix la liste des souvenirs signaux, pour favoriser le processus d’intégration. Il est ainsi possible d’imaginer que ce canal essentiellement auditif, ne permette pas le traitement de l’information attendu, pour des personnes disposant de particularités sensorielles.
C’est ainsi qu’a émergé l’idée de chercher, avec certains patients, une approche plus propice que la répétition à haute voix de la Ligne du Temps
AFICV : Chloé est-ce que vous pouvez préciser ce que recouvre la notion de « spécificités sensorielles » ?
Chloe : La première chose est de rappeler que nous avons 9 sens et pas 5 !
En complément des 5 sens bien connus que sont : la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût on retrouve
la proprioception (ou sens kinesthésique c’est-à-dire notre capacité à identifier l’emplacement de nos propres membres) ,
l’équilibrioception (ou sens vestibulaire), fortement liée à l’audition, qui détermine notre sens de l’équilibre,
la thermoception (ou thermo-réception c’est-à-dire notre aptitude à détecter la température)
et la nociception qui est le sens de la douleur.

En second lieu, les modes de perception diffèrent, notamment chez les personnes avec un TSA, ce qui influence leur perception du monde. Elles sont par ailleurs soumises à des hypo et/ou hypersensibilités.
Dans le cas de l’hypersensibilité, le seuil de réaction est en dessous de la norme, la personne va réagir plus vite à un stimuli et cela peut même potentiellement, être douloureux plus vite, ou inconfortable, ou fatiguant.
Dans le cas de l’hyposensibilité, c’est l’inverse ! Le seuil de réaction va être plus haut que la norme. Dans ce cas, la personne va être plutôt en recherche de sensations, pour sentir quelque chose !
Par exemple, concernant les stéréotypes de la personne autiste qui ne supporte pas le bruit, il s’agit d’une hypersensibilité auditive ; et ceux de la personne autiste qui se balance, d’une hyposensibilité vestibulaire, il y a une recherche de sensations. Ces représentations sont correctes même si les particularités sensorielles ne se limitent pas à ces comportements stéréotypés et sont différentes pour chaque personne avec un TSA.
Il peut être utile de préciser que la reconnaissance des « spécificités sensorielles » a été ajoutée dans la version 5 du DSM, comme critère de diagnostic du TSA.
AFICV : en quoi est-ce important de prendre en compte le profil sensoriel de nos patients ?
Chloë : Le cerveau d’une personne avec un TSA ou d’une personne neuro-atypique traite beaucoup plus d’informations que le cerveau d’une personne neurotypique c’est à dire sans troubles du neurodéveloppement. Il a du mal à filtrer les informations. Si, dans le cabinet, nous ne respectons pas son profil sensoriel, le patient a zéro « bande passante » pour être avec nous.
C’est donc vraiment hyper important de poser des questions pratico-pratiques !
Si vous dites à un patient : est-ce que vous êtes gêné par la lumière ? il va peut-être vous dire non ! Par contre si vous lui demandez : est-ce que vous fermez les volets chez vous ? et qu’il vous dit « oui » ou que « les volets sont toujours un peu baissés », cela signifie qu’il est gêné par la lumière mais n’a pas compris que c’est ça, être gêné par la lumière !
Autre exemple, dans un restaurant, la personne neuro-atypique va percevoir au même niveau : la conversation de la personne en face d’elle, la fourchette qui tombe à la table d’à côté, les personnes qui entrent dans la salle, les multiples conversations, la serveuse qui est en train d’écrire sur son bloc-notes, l’appareil à carte bleue qui fait bip…..
Cela demande un niveau de concentration énorme pour être présent à ce qui se passe dans la conversation !
Si dans le cabinet on ne l’a pas pris en compte, l a personne n’est pas là !
AFICV : Est-ce qu’il y a un moyen rapide, simple de détecter ces profils dès les premières rencontres, en particulier avec les personnes qui ne sont pas diagnostiquées ? des tests ?
Chloë : Il est beaucoup plus facile de percevoir les hypersensibilités que les hyposensibilités ! Les personnes vont plus facilement dire qu’elles sont gênées, alors que si elles ne sentent rien c’est plus compliqué! C’est vraiment en les interrogeant que l’on va s’en rendre compte.
Cécile : Dans ma pratique en traumatologie, que ce soit TSA ou pas TSA, le principe est toujours de demander ce qui est confortable pour les gens. Déjà les patients choisissent leur siège ; est ce qu’il y a trop ou pas assez de lumière ? j’ai des LED au plafond que je peux éteindre et réguler avec des lampadaires. Est-ce qu’il y a besoin d’un plaid ou d’une couverture lestée qui sont à disposition ? Si vous cotez les 3 (NDLR : kinesthésique/auditif / visuel), à priori, on peut penser, neuro-atypie
Chloë : J’ai un patient qui est capable d’entendre la ventilation qui gère le cabinet médical à l’étage d’en dessous ! Moi, je ne l’entends pas et pourtant, je pense être quelqu’un très sensible au bruit. Cela donne aussi des indications.
Certains patients utilisent aussi des casques antibruit ce qui leur permet de filtrer les bruits ou des bouchons de type « Loop » qui sont des bouchons réutilisables, adaptés pour bien entendre. La question de « est-ce que vous êtes confortable ? » est une base !
Parfois, sachant que les patients ne vont pas forcément oser le dire il faut insister un peu «si vous changez d’avis, on peut régler la lumière, on peut y revenir, vous avez le droit…… !»
Cécile : A noter qu’il est possible d’être hyper et hypo sensible parfois sur le même sens en même temps ! La personne peut à la fois dire qu’elle ne supporte pas le bruit, mais avoir besoin de quelque chose de permanent, par exemple d’écouter de la musique non-stop avec un casque toute la journée, cette spécificité pouvant alors entrer en conflit avec la façon dont se pratique LI-ICV !
AFICV : à quel moment ou selon quels critères doit-on se poser la question de l’adaptation des protocoles LI-ICV au profil sensoriel du patient ?
Chloë: En cherchant un peu dans la littérature, on peut remarquer que pendant longtemps, les personnes avec TSA étaient plutôt décrites comme des penseurs visuels. Toutes les études ne sont pas d’accord sur le sujet, mais à priori, ces personnes encodent plus facilement dans la durée, quand c’est le canal de la vue qui est utilisé.
Donc si on se rend compte (NDLR – en ICV) que l’utilisation du canal auditif, avec une personne, ne donne pas les résultats que l’on a l’habitude d’avoir, c’est là où l’on peut envisager une autre méthode.
Ainsi, on peut dire à la personne : « je vais vous proposer la même chose par écrit, est-ce que c’est mieux ? ».
Certaines études suggèrent aussi que ces personnes sont plus à l’aise sur une seule modalité à la fois. Si on utilise le canal visuel et que l’on fait du bruit en même temps, en parlant par exemple, c’est peut-être trop de stimulation ! la surcharge sensorielle est également possible, même si on est sur un protocole uniquement verbal, du fait de tous les bruits parasites qu’il peut y avoir autour. Dans ces cas également, il peut être intéressant de tester ces 2 canaux sensoriels.
Et puis on peut utilement demander aux patients comment eux, ils apprennent. Comment pour eux, c’est plus facile ? est ce qu’ils écoutent des podcasts ou au contraire est-ce qu’ils n’arrivent pas à maintenir leur attention dessus ? Est-ce qu’ils préfèrent regarder une vidéo YouTube, parce qu’il y a une information visuelle en plus de l’Auditif ? est ce qu’ils vont mettre les sous-titres ? Ou pas ?
On va ainsi obtenir de l’information utile plus facilement !
******************
AFICV : Cécile, au niveau de votre pratique, pouvez-vous nous dire ce qui vous a amenée à adapter les protocoles LI-ICV ?
Cécile : je peux retracer l’historique de « comment j’en suis venue à adapter » et surtout comment j’en suis venue à « comprendre pourquoi j’adaptais » ces protocoles.
Le début de l’histoire démarre avec un patient très dissocié, en suivi depuis plusieurs années, qui a des traits autistiques marqués et de nombreux critères diagnostiques du DSM-5.
Ce patient a un parcours de victimisation qui démarre à sa naissance et qui s’arrête il y a environ quatre ans ; carences et maltraitances familiales, violences sexuelles enfant et adolescent, associées à un tableau de décompensation psychiatrique à l’adolescence puis comme jeune adulte, et de multiples hospitalisations qui renforcent son vécu de maltraitance, au niveau hospitalier.
Ce patient travaille dans le milieu de la santé et est régulièrement déclenché par ces souvenirs de maltraitances hospitalières.
Toutes les expériences EMDR antérieures se sont soldées par des tentatives de suicide avec passage en réanimation. Son récit sur ces multiples hospitalisations est flou et je ne sais plus de quelle hospitalisation il me parle. Je décide donc de faire de l’intégration du cycle de vie, et cela ne fonctionne pas. L’alliance thérapeutique est bonne, cela fait 1 an qu’il vient, mais il sort de sa fenêtre de tolérance, même avec peu de souvenirs.
Je finis par lui demander ce qu’il en pense et il me répond que c’est intolérable tout ce que je lui donne comme information. Il ne peut pas traiter autant d’information, ça déborde !
Lorsque je lui demande s’il a une idée sur le comment faire, il indique que ça l’aiderait de pouvoir dessiner une image par souvenir. L’image qu’il regarde lui permet de fixer les choses et ne pas partir « en arborescence ».
Il explique par exemple que lorsqu’il entend le souvenir signal «CPE du lycée», il revoit le CPE, le couloir dans lequel se trouve le bureau, le CDI à côté, et le CDI le renvoie à une des agressions subies.
Je prépare donc un classeur avec une image pour chaque souvenir rangé dans l’ordre chronologique, dans une pochette plastique.
Lors des protocoles, je déroule pochette par pochette, ou toutes les 4 pochettes par exemple si besoin de faire des bonds. Je ne dis pas un mot pour ne pas multiplier les canaux sensoriels, en adaptant la vitesse de déroulé au besoin.
AFICV : avez-vous constaté des changements avec cette adaptation ?
Cécile : Cette méthode a donné de bons résultats et notamment l’obtention d’une ligne du temps qui remonte avant la période des hospitalisations. A ce jour, ce patient a une biographie, qui remet les évènements dans l’ordre. Les hospitalisations restent des mauvais souvenirs mais cela a amené un apaisement.
L’utilisation du canal visuel a permis à ce patient de réduire le temps de traitement de l’information, en supprimant le phénomène de « résonnance » ou de décalage, généré par le temps de traitement du souvenir via le canal auditif (cf ci-dessus « CPE du Lycée »)
AFICV : Y a-t-il eu d’autres situations dans lesquelles vous avez été amenée à adapter les protocoles LI-ICV ?
Cécile : Le 2nd exemple concerne un patient avec un TSA, accompagné précédemment dans un parcours de transition de genre et qui revient à la suite d’une rupture amoureuse difficile.
La 1ère séance permet d’écrire avec lui la ligne du temps de la relation, puis de travailler en Protocole Relationnel (NDLR : PR) à la séance suivante.
Souvent dans la transition de genre, il y a un avant et un après. La thérapie LI-ICV a permis, pour ce patient, d’améliorer la cohérence du soi.
AFICV : Donc pour ce patient, l’utilisation du canal auditif n’ayant pas permis d’intégration, vous avez privilégié le canal visuel ?
Cécile : Les patients neuro-atypiques vont être marqués par des éléments souvent spécifiques comme : « à la crèche, les pieds des enfants » ou « le camion jaune » et leurs souvenirs vont porter principalement sur la sensorialité.
Voir la ligne du temps écrite est souvent aidant, même si certains patients peuvent nous dire que ce n’est pas utile ; il peut parfois être pertinent d’aller un peu à l’encontre de ce qu’ils nous disent.
AFICV : Tous les patients peuvent-ils aussi aisément préciser ce qui est aidant pour eux ? s
Cécile : Pour qu’ils puissent faire un retour sur leur expérience en séance, ils doivent avoir travaillé dans un premier temps sur leur capacité à repérer, puis à s’exprimer. L’étroite collaboration avec Chloé qui par son accompagnement, leur permet de distinguer les sensations, les émotions… développe ce type de compétences. Il est probable qu’un patient n’ayant pas bénéficié préalablement d’une thérapie spécialisée autisme ne sera pas ou peu réceptif à la thérapie LI-ICV.
AFICV : Le thérapeute LI-ICV doit donc s’assurer que le patient peut échanger sur son expérience sensorielle et communiquer sur ses besoins ?
Cécile : Oui mais ce n’est pas toujours aussi simple. Je pense à une patiente, orientée par Chloé pour travailler sur un TSPT (Trouble de Stress Post Traumatique) lié à une opération chirurgicale et des soins post opératoires qui se sont mal passés, en contexte COVID. Cette patiente présente un tableau sévère dans ses traits autistiques, dans sa verbalisation mais aussi dans son accordage, avec notamment une absence totale de regard dirigé.
Face à une absence de verbalisation, le thérapeute LI-ICV pourrait comprendre que si le patient n’a rien à dire, c’est qu’il est dissocié, et donc s’orienter vers le trauma.
La patiente a validé le travail avec le canal auditif mais en demandant une réduction importante du rythme de lecture, ce qui l’a beaucoup aidée. Il faut parfois aller contre sa nature de thérapeute LI-ICV !
Aller vite avec cette patiente, en protocole TSPT, aurait été pour elle, intolérable.
Le risque de ne pas tenir compte de la particularité de son fonctionnement aurait été de ne voir que du figement, à tous les passages, alors qu’en fait, il se passait beaucoup de choses pour elle, qu’elle ne verbalisait pas vraiment.
AFICV : On retrouve ici cette notion de nécessaire adaptation à la « bande passante » disponible du patient, quant à la dose d’informations donnée et le choix du canal sensoriel utilisé ?
Chloé : cette bande passante peut être illustrée par un stylo à plusieurs couleurs ! Dans un fonctionnement neuro-atypique, le stylo n’a pas 4 couleurs, mais 12 !
Chaque couleur correspond à une pensée et est utilisée en même temps, ce qui provoque une saturation, il ne se passe rien ! Il y a trop d’information ! Ce qui pourrait être assimilé à du figement.
Au-delà des situations traumatiques, il faut aller plus loin et les particularités sensorielles sont à prendre en compte.
AFICV : C’est ce que vous souhaitez illustrer par ce dernier cas clinique Cécile ?
Cécile : La dernière situation est en effet celle d’une patiente qui consulte pour une dépression post-traumatique, liée à des violences conjugales et incestueuses.
Mon orientation traumatologie m’amène à travailler directement cet aspect dans les 1ères séances ! Au fur et à mesure de la thérapie, la patiente parle de sentiment de rejet et d’incompréhension.
A travers son récit d’une situation de la vie quotidienne, il apparait que cette patiente ne comprend pas l’implicite ayant un trouble de la cognition sociale massif, dans le cadre d’un TSA caractérisé. Au vu de son histoire de vie, le TSA, est, dans un 1er temps, passé inaperçu.
Dans ma pratique clinique, il est fréquent de voir apparaitre un trouble neurodéveloppemental sous-jacent, après avoir traité une partie de l’histoire traumatique, quand cela va un peu mieux, ce qui peut conduire à considérer que ce type de trouble constitue sans doute un facteur de vulnérabilité au trauma.
AFICV : Est- ce que l’utilisation de LI-ICV permet d’améliorer les troubles liés à l’autisme au-delà de ceux liés au trauma ?
Cécile : pour moi, le LI-ICV est une thérapie de traitement du trauma donc je ne vais pas l’utiliser pour un trouble de la cognition sociale ou d’autres particularités de fonctionnement. Mais le travail en LI-ICV permet que la personne puisse, quand le trauma est traité, distinguer dans son fonctionnement ce qui est de l’ordre du trauma et ce qui est de l’ordre de ses particularités, avec lesquelles elle va devoir apprendre à faire avec.
Chloé : et ne pas vouloir aller contre
Cécile : oui en effet, car c’est un facteur d’épuisement et de vulnérabilité psychiatrique.
Chloé : souvent associé à une estime de soi déplorable car « c’est tout le temps de ma faute ».
Cécile : en dehors du purement traumatique la thérapie LI-ICV, peut permettre une amélioration de la cohérence du soi ; c’est-à-dire que dans le TSA (mais aussi le TDAH) il y a un facteur de fragilité identitaire. De ce point de vue, la thérapie LI-ICV est un facteur de reconsolidation identitaire.
Le travail d’intégration permet à ces patients de se dire « c’est ma vie » dans son ensemble et pas par morceaux.
Chloé : j’ajouterais que cela peut aussi être intéressant en termes mnésiques. Avec ces profils, il faut activer les bonnes arborescences pour que les souvenirs se déclenchent, ce qui donne des histoires de vie très morcelées alors que LI-ICV va offrir le sentiment d’une continuité et donc d’une cohérence beaucoup plus confortable à vivre.
A la troisième séance, son feed-back met en évidence que le PR ne l’a pas aidé ; par contre il précise que la séance d’écriture de la ligne du temps a été plus bénéfique pour lui.
L’utilisation d’un classeur avec des pochettes plastiques comprenant cette fois un mot par souvenir a permis de faire des lignes du temps entières apportant une stabilisation dans son identité.
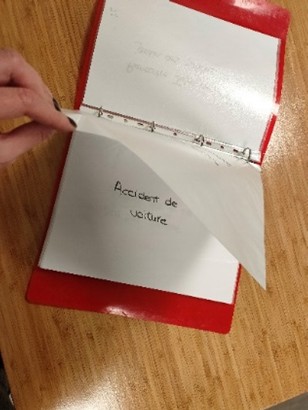
Souvent dans la transition de genre, il y a un avant et un après. La thérapie LI-ICV a permis, pour ce patient, d’améliorer la cohérence du soi.
AFICV : Donc pour ce patient, l’utilisation du canal auditif n’ayant pas permis d’intégration, vous avez privilégié le canal visuel ?
Cécile : Les patients neuro-atypiques vont être marqués par des éléments souvent spécifiques comme : « à la crèche, les pieds des enfants » ou « le camion jaune » et leurs souvenirs vont porter principalement sur la sensorialité.
Voir la ligne du temps écrite est souvent aidant, même si certains patients peuvent nous dire que ce n’est pas utile ; il peut parfois être pertinent d’aller un peu à l’encontre de ce qu’ils nous disent.
AFICV : Tous les patients peuvent-ils aussi aisément préciser ce qui est aidant pour eux ? s
Cécile : Pour qu’ils puissent faire un retour sur leur expérience en séance, ils doivent avoir travaillé dans un premier temps sur leur capacité à repérer, puis à s’exprimer. L’étroite collaboration avec Chloé qui par son accompagnement, leur permet de distinguer les sensations, les émotions… développe ce type de compétences. Il est probable qu’un patient n’ayant pas bénéficié préalablement d’une thérapie spécialisée autisme ne sera pas ou peu réceptif à la thérapie LI-ICV.
AFICV : Le thérapeute LI-ICV doit donc s’assurer que le patient peut échanger sur son expérience sensorielle et communiquer sur ses besoins ?
Cécile : Oui mais ce n’est pas toujours aussi simple. Je pense à une patiente, orientée par Chloé pour travailler sur un TSPT (Trouble de Stress Post Traumatique) lié à une opération chirurgicale et des soins post opératoires qui se sont mal passés, en contexte COVID. Cette patiente présente un tableau sévère dans ses traits autistiques, dans sa verbalisation mais aussi dans son accordage, avec notamment une absence totale de regard dirigé.
Face à une absence de verbalisation, le thérapeute LI-ICV pourrait comprendre que si le patient n’a rien à dire, c’est qu’il est dissocié, et donc s’orienter vers le trauma.
La patiente a validé le travail avec le canal auditif mais en demandant une réduction importante du rythme de lecture, ce qui l’a beaucoup aidée. Il faut parfois aller contre sa nature de thérapeute LI-ICV !
Aller vite avec cette patiente, en protocole TSPT, aurait été pour elle, intolérable.
Le risque de ne pas tenir compte de la particularité de son fonctionnement aurait été de ne voir que du figement, à tous les passages, alors qu’en fait, il se passait beaucoup de choses pour elle, qu’elle ne verbalisait pas vraiment.
AFICV : On retrouve ici cette notion de nécessaire adaptation à la « bande passante » disponible du patient, quant à la dose d’informations donnée et le choix du canal sensoriel utilisé ?
Chloé : cette bande passante peut être illustrée par un stylo à plusieurs couleurs ! Dans un fonctionnement neuro-atypique, le stylo n’a pas 4 couleurs, mais 12 !
Chaque couleur correspond à une pensée et est utilisée en même temps, ce qui provoque une saturation, il ne se passe rien ! Il y a trop d’information ! Ce qui pourrait être assimilé à du figement.
Au-delà des situations traumatiques, il faut aller plus loin et les particularités sensorielles sont à prendre en compte.
AFICV : C’est ce que vous souhaitez illustrer par ce dernier cas clinique Cécile ?
Cécile : La dernière situation est en effet celle d’une patiente qui consulte pour une dépression post-traumatique, liée à des violences conjugales et incestueuses.
Mon orientation traumatologie m’amène à travailler directement cet aspect dans les 1ères séances ! Au fur et à mesure de la thérapie, la patiente parle de sentiment de rejet et d’incompréhension.
A travers son récit d’une situation de la vie quotidienne, il apparait que cette patiente ne comprend pas l’implicite ayant un trouble de la cognition sociale massif, dans le cadre d’un TSA caractérisé. Au vu de son histoire de vie, le TSA, est, dans un 1er temps, passé inaperçu.
Dans ma pratique clinique, il est fréquent de voir apparaitre un trouble neurodéveloppemental sous-jacent, après avoir traité une partie de l’histoire traumatique, quand cela va un peu mieux, ce qui peut conduire à considérer que ce type de trouble constitue sans doute un facteur de vulnérabilité au trauma.
AFICV : Est- ce que l’utilisation de LI-ICV permet d’améliorer les troubles liés à l’autisme au-delà de ceux liés au trauma ?
Cécile : pour moi, le LI-ICV est une thérapie de traitement du trauma donc je ne vais pas l’utiliser pour un trouble de la cognition sociale ou d’autres particularités de fonctionnement. Mais le travail en LI-ICV permet que la personne puisse, quand le trauma est traité, distinguer dans son fonctionnement ce qui est de l’ordre du trauma et ce qui est de l’ordre de ses particularités, avec lesquelles elle va devoir apprendre à faire avec.
Chloé : et ne pas vouloir aller contre
Cécile : oui en effet, car c’est un facteur d’épuisement et de vulnérabilité psychiatrique.
Chloé : souvent associé à une estime de soi déplorable car « c’est tout le temps de ma faute ».
Cécile : en dehors du purement traumatique la thérapie LI-ICV, peut permettre une amélioration de la cohérence du soi ; c’est-à-dire que dans le TSA (mais aussi le TDAH) il y a un facteur de fragilité identitaire. De ce point de vue, la thérapie LI-ICV est un facteur de reconsolidation identitaire.
Le travail d’intégration permet à ces patients de se dire « c’est ma vie » dans son ensemble et pas par morceaux.
Chloé : j’ajouterais que cela peut aussi être intéressant en termes mnésiques. Avec ces profils, il faut activer les bonnes arborescences pour que les souvenirs se déclenchent, ce qui donne des histoires de vie très morcelées alors que LI-ICV va offrir le sentiment d’une continuité et donc d’une cohérence beaucoup plus confortable à vivre.
Pour aller plus loin
Les podcasts
https://centre-ressource-rehabilitation.org/a-ecouter-podcast-troubles-dans-le-spectre
https://open.spotify.com/show/32cleZOUgewtvsS7TlbPOE
https://open.spotify.com/show/4hUKYuftbxbODofOzwmg3h
Les livres
En anglais non traduits
“UNMASKED: The Ultimate Guide to ADHD, Autism and Neurodivergence » & “How to be You” – Ellie Middleton – Ed. Pinguin Life
“Unmasking Autism – The Power of Embracing Our Hidden Neurodiversity” – Dr Devon Price – Ed. Monoray
« Autisme au féminin : Approches historique et scientifiques, regards cliniques » (2023), Ed. UGA ou accessible en OpenEditionBooks – https://books.openedition.org/ugaeditions/29765?lang )
« La différence invisible » de Julie DACHEZ et Mademoiselle CAROLINE (2016), Editions Delcourt/Mirages

